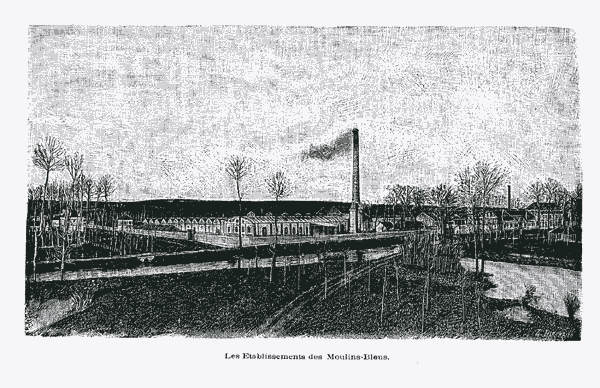
| L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL | |||
| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |
Les Grandes usines, par Julien Turgan, est une série de volumes imprimés (avec planches) qui dresse un tableau descriptif des grands établissements industriels français dans le milieu de la seconde moitié du XIXe siècle. Les Etablissements Saint-Frères eurent l’honneur de ces publications.
On trouve d'abord une publication, concernant Saint-Frères, où la société, qui possède déjà un établissement à L'Etoile, vient d'acquérir le site des Moulins-Bleus pour y construire une nouvelle usine.
[Catalogue du CNAM : http://cnum.cnam.fr/RUB/fcata.html].
Tome 15 (1882-83) – L'article développe des informations généalogiques sur la famille Saint puis traite de l'usine d'Harondelle (Somme) avec un long développement sur le jute. L'auteur ne consacre alors que quelques lignes à L'Etoile et aux Moulins-Bleus, mais l'on sait que l'achat de l'ancienne usine de toile à voile des Moulins-Bleus ne sera signé que le 5 février 1883. En fin de partie de l'ouvrage (p. 15), on peut lire :
« Malgré les difficultés que les usines Saint rencontrent, comme nos autres établissements industriels français, leur activité est telle que MM. Saint ne craignent pas, au milieu même de la crise industrielle qui sévit, de construire à Moulins-Bleus une usine aussi importante que ses devancières, et qui portera à 135 000 mètres leur production journalière de toile à sacs, etc., production la plus considérable peut-être qui existe. »
Ces informations sont concordantes avec une mention de l'année 1881 citée dans le texte (p. 4) et les chiffres de l'introduction, où il est fait mention d'une production, par jour, de la maison de 85 000 mètres de tissus (p. 1). Au cœur du texte (p. 4), on peut aussi noter que : « Aujourd’hui, les principaux établissements sont : ... 4. Moulins-Bleus (Somme). Filature et Tissage mécaniques ; 5. L’Etoile (Somme). Tissage semi-mécanique ».
On a donc la confirmation qu'à L'Etoile (face à la rue au Sac) se trouvait un atelier (rapidement voué à disparaître), et que l'on y travaillait alors avec des techniques à mi-chemin entre le tout à la main et la mécanisation, contrairement aux Moulins-Bleus, où tout serait mécanisé.
On dispose d'une autre exposé de J. Turgan, plus tardif (1894), qui reprend, actualise et complète l'article précédent. Cette fois l'usine des Moulins-Bleus y fait l'objet de tout un chapitre, très élogieux – mais c'est une habitude chez J. Turgan !
L'auteur ne s'attarde pas à commenter l'activité de la "classe laborieuse" qui travaillait dans cette usine, son point de vue est celui de la production, sa passion, celle des machines et des techniques. Néanmoins, à la lecture des chiffres de production et à la vue de ces multitudes de machines-outils, on ressentira nécessairement la présence de cette ruche humaine rythmée par l'heure télégraphique de Flixecourt et au travail derrière des machines mues par deux monstres à vapeur auxquels l'auteur voue toute son admiration. Femmes à la filature, hommes au tissage, tous liés par la fabrication de la toile de jute, voici la description de leur cadre de travail aux usines Saint-Frères des Moulins-Bleus à L'Etoile, précédée d'un historique et de données généalogiques concernant la famille de leur employeur, les membres de la société Saint-Frères.
[Texte intégral, p. 1 à 3 (BMA, Pic 1907, Revue de février 1894, 46 pages)] « Il est un nom qu'on entend, à tout instant, lorsqu'on parcourt, dans le département de la Somme, la région entre Abbeville et Doullens : c'est celui de MM. Saint frères.
On doit à cette famille, justement vénérée, l'activité industrielle et le mouvement commercial créés dans bien des localités ainsi que la vie plus facile et le bien-être, dont jouissent maintenant les habitants de bourgs et de villages jadis peu favorisés.
Que leur initiative féconde se soit manifestée sous la forme de travail donné aux ouvriers, ou sous celle d'une généreuse bienfaisance, elle n'en est pas moins hautement reconnue et appréciée des populations picardes, qui, depuis plus d'un siècle, doivent à ces manufacturiers, aussi, laborieux qu'intelligents, la transformation de toute une contrée que les travaux agricoles, généralement si peu rémunérateurs, n'avaient pu enrichir. MM. Saint ont merveilleusement réalisé la pensée de Cormenin : « Donner du travail, c'est plus, c'est mieux que de donner de l'argent. »
Et c'est au moment où Mirabeau proclamait celte vérité axiomatique : « le travail seul constitue une nation », que MM. Pierre, François et Aimable Saint la mettaient en pratique, en inaugurant à Beauval, près de Doullens, la fabrication à la main des toiles d’emballage, en étoupes de lin. Le jute était encore inconnu en France ; son application dans l’industrie y date seulement de 1835.
Mais les déchets des textiles récoltés dans le pays constituaient déjà une matière première suffisante, au début, pour la fabrication de ces tissus grossiers, dont la vente était alors limitée à un rayon de quelques lieues. En peu d’années, les produits que MM. Saint frères faisaient tisser à Beauval, étant appréciés du commerce amiénois, trouvèrent successivement des débouchés, de plus en plus importants, du côté du Nord et de la Normandie.
Du reste, les trois associés avaient bien dressé leur plan. Tandis que Pierre Saint restait à Beauval pour y suivre la fabrication avec son frère François qui, de là, se rendait à Amiens et dans le Nord, pour y acheter des matières à filer et à tisser (lin et étoupes) et pour vendre de la toile, le troisième, Aimable, s'était installé à Rouen, centre de grande consommation de toile d'emballage, pour y écouler la majeure partie des produits de Beauval.
La vente s'étant développée, à Rouen, sous l'active et intelligente impulsion d'Aimable, qui avait appelé auprès de lui ses deux gendres Candas Saint et Victor Saint, il s'entendit avec ses frères pour fonder, à la fin de 1838, une maison de vente place du Chevalier-du-Guet, n° 8, à Paris, et y déléguer Victor Saint pour la diriger.
Pierre avait quatre fils : Victor, Jean-Baptiste, Charles et François-Xavier, et une fille.
François avait deux fils : François-Joseph, Jules-Abel, et deux filles, dont l'une est Mme Charles Saint.
Aimable avait un fils : Jean-Baptiste, dont la mauvaise santé l'a empêché d'intervenir, et deux filles, dont l'une mariée à M. Candas Saint, l'autre à M. Victor Saint.
La maison de Paris prit vite de l'extension, grâce à Jean-Baptiste et à Charles Saint, qui vinrent de Beauval, rejoindre leur frère Victor en 1839 et en 1841, ce que fit François-Xavier quelques années plus tard.
MM. Pierre, François, Aimable, Candas, Victor, Jean-Baptiste Saint sont morts successivement ; ce dernier, chevalier de la Légion d'honneur. MM. François-Joseph et François-Xavier se sont retirés des affaires en 1863 et 1872.
Les chefs actuels sont : Charles Saint, Jules-Abel Saint, chevaliers de la Légion d'honneur ; Guillaume Saint, fils de M. Charles Saint ; Henri Saint, fils de Jean-Baptiste Saint.
Vers 1840, MM. Saint frères durent également à l'utilisation d'un filament de provenance indienne, le jute, un accroissement de leur production en raison du bon marché relatif de cette matière première, alors nouvelle.
A la toile d'emballage, MM. Saint frères joignirent, vers 1845, la fabrication de la toile à sacs, puis, un peu plus tard, la confection des sacs.
En 1848, le fondateur de la maison, M. Victor Saint, abandonnait à MM. Jean-Baptiste et Charles la direction de l'entreprise, et ceux-ci s'assuraient la collaboration de leur quatrième frère, François-Xavier, et celle de M. Jules Saint, fils de François.
En 1856, ils firent à Paris, rue de Ménilmontant, 74, un essai pratique au moyen de machines et de métiers spéciaux, étudiés par eux, du tissage mécanique des toiles communes en jute, pour sacs, qui se tissaient jusque-là à la main, en raison du peu de solidité de la matière employée. Depuis 1841, le jute se filait déjà mécaniquement.
En 1857, cet essai difficile et très coûteux ayant réussi, ce qui réalisait un progrès énorme, puisque l'emballage et l'ensachage de toutes les marchandises se font aujourd'hui à moitié prix d'il y a trente ou quarante ans, [sic (suite après le paragraphe ci-dessous)].
On ne se figure guère l'importance que l'emballage a pris depuis un certain nombre d'années et quelles sommes considérables il absorbe relativement à celles employées à l'acquisition des produits qu’il doit contenir et préserver contre tout dommage, toute altération. Et ces articles pour l'emballage d'une aussi incontestable utilité, il les faut livrer à des prix infimes. Ainsi, il y a des toiles d'emballage à 15 centimes le mètre carré ; il se vend des pelotes de ficelle à moins de dix centimes ! N'est-ce pas là un immense service rendu à l'industrie et à la culture que de pouvoir livrer pour presque rien ces enveloppes-sacs, ces toiles d'emballage et ces liens de toute sorte, sans lesquels il serait impossible de transporter les mille produits, en dehors des matières pulvérulentes (farines, engrais, ciments, etc.) qu'on expédie aujourd'hui plus que jamais en toile perdue, c'est-à-dire en emballages qui ne sont pas rendus aux expéditeurs.
MM. Saint organisèrent à Flixecourt (Somme), non loin de Beauval, qui est leur village natal, un premier établissement de tissage mécanique inauguré en 1857 et dont M. Jean-Baptiste Saint fut plus particulièrement chargé. Le choix de Flixecourt se justifiait parce que ce point réunissait les éléments de réussite nécessités par une grande industrie et ses développements : d'une part, des ouvriers intelligents et ayant les aptitudes premières ; et, d'autre part, une eau favorable, celle d'une petite rivière d'un cours régulier et abondant.
L'établissement de Flixecourt prospéra et son développement devint si important que la création d'autres établissements dans le voisinage fut décidée successivement. On commença par celui d'Harondel, à 6 kilomètres de Flixecourt, en 1861, pour filature et tissage du jute ; puis, en 1863, on érigea, à Saint-Ouen, à trois kilomètres d'Harondel, une filature du lin, du chanvre et du jute.
Plus tard, MM. Saint frères achetèrent l'usine des Moulins-Bleus, où se fabriquait alors la toile à voiles, et y établirent la filature et le tissage du jute. Enfin, l'agglomération des usines Saint se compléta par l'achat de celle de Pont-Remy, où la Société linière de ce nom exploitait la filature et le tissage du lin, du chanvre et du jute. La transformation et l'agrandissement de l'usine de Pont-Remy permit la suppression de deux fabriques annexe ; le tissage de l'Etoile, près Flixecourt, et celui de Luneray (Seine-Inférieure), où se faisaient de petites toiles spéciales à la main.
Ces divers établissements, sauf celui de Pont-Remy établi sur la Somme, sont situés dans la vallée de la Nièvre, sur la rivière de ce nom, allant se jeter dans la Somme, à Moulins-Bleus, après avoir fourni, sur une étendue de 13 kilomètres, de la force motrice aux usines disposées sur ses rives, lesquelles usines occupent ensemble une superficie de près de 800 000 mètres carrés.
Flixecourt est toujours resté l'établissement central et dirigeant, auquel les autres sont reliés par un réseau télégraphique et téléphonique qui permet notamment de régler uniformément les heures de travail des diverses usines, au moyen d'appareils électriques.
Chaque année, tous les établissements Saint s'accroissent d'annexes [...] ».
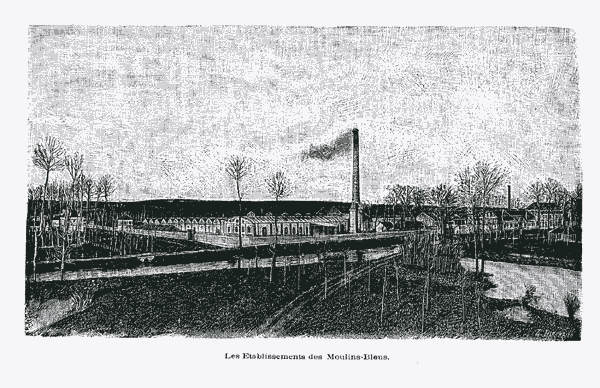
[Texte intégral, p. 32 à 36, Pl. p. 33] « Depuis 1883, MM. Saint frères possèdent, non loin de Flixecourt, à Moulins-Bleus, une filature de jute de plus de 6 000 broches, ainsi qu'un tissage d'environ 500 métiers. Cette manufacture a subi, de par leur volonté de perfectionner sans cesse, une transformation radicale. Des métiers neufs ont remplacé une centaine de métiers anciens et le millier de broches a été quadruplé et rénové.
L'atelier principal n'a pas moins de 160 mètres de longueur sur 84 de largeur, d'un seul tenant. Quant aux chaudières et moteurs anciens, le tout a été revendu et avantageusement remplacé par une machine Compound, de 600 chevaux, du constructeur Boyer, et une autre de 800 chevaux, de Dujardin, de Lille.
Parcourons rapidement les ateliers, guidé par le directeur de cet établissement.
Tout d'abord, on se trouve en présence de machines dites ouvreuses, dont le travail consiste à opérer un commencement de division dans les grosses poignées de jute ; un double jeu de cylindres brise la masse et surtout les pieds de la plante.
Le jute arrive de l'Inde par balles de 180 kilos, sans aucun emballage ; les filaments, auxquels la compression à la presse hydraulique donne la dureté du bois, sont simplement maintenus par des liens solides qu'on coupe à la hache.
De l'ouvreuse, le jute est amené aux machines assouplisseuses de Urquivart, formées de 60 rouleaux cannelés superposés dont quelques ressorts maintiennent l'écartement voulu.
En sortant des assouplisseuses, le jute est soumise à l'ensimage, dont l'objet est de pénétrer le jute d'humidité, de façon à lui rendre sa flexibilité.
Cet ensimage est pratiqué avec une émulsion chaude, composée avec de l'eau savonneuse avec laquelle on a agité dans des baquets un mélange d'huiles de lin et autres. Le jute étant disposé en lits successifs formant croix entre eux, l'aspersion de l'émulsion est faite à l'aide de grosses seringues de la contenance d'environ 10 litres. Chaque superposition de trois ou quatre lits de jute donne lieu à un seringuage.
Au sortir de l’ensimage et d'un ressuage de vingt-quatre à quarante-huit heures, selon la saison, le jute est soumis aux cardes briseuses formées de deux rouleaux à cardes superposés, auxquels une toile sans fin amène les filaments bruts. La matière en sort transformée en matière peignée. Remarquons, en passant, que ces machines, comme toutes celles en mouvement dans les usines Saint frères, sont entourées de grillages et que les précautions les plus prévoyantes sont partout prescrites et appliquées. C'est ainsi, par exemple, que nous lisons la défense de nettoyer les machines en marche, sous peine de cinq francs d'amende.
L'épiétage du jute est ici obtenu dans les meilleures conditions avec l'épiéteuse construite par la Fairbairn, Naylor, Macpherson and C° limited, de Leeds.
Des chaînes sur poulies à gorges brisent les pieds du jute et l'opération se termine par les peignes à carde.
Dans toutes ces opérations, la poussière qui se dégage n'est point toxique ; elle est, du reste, enlevée, en très grande partie, par des ventilateurs puissants. Les déchets sans valeur de la filature ou des cardes entrent dans la composition d'engrais ; ils pourraient également être utilisés par les fabriques de cartons ; mais celles-ci ne consentiraient à les payer qu'un prix qui ne couvrirait pas les frais de transport et d'emmagasinage.
A la suite de ces traitements, notamment de celui dans les cardes briseuses, le jute passe dans les cardes finisseuses, garnies de peignes successivement plus fins, puis au cylindrage, d'où la matière sort en rubans réguliers. Ce cylindrage s'opère entre des rouleaux cannelés bien assemblés avec un gros rouleau garni de cuir. Les étirages se font ensuite sur des machines très ingénieuses de Fairbairn, dans lesquelles le ruban est aussi lissé par de véritables filières, où ils se doublent ou triplent avant de subir le cylindrage. Avant d'être prêt pour la filature, le ruban de jute est travaillé par les bancs à broches du même constructeur, qui donnent la première préparation de fil.
Les métiers à filer, qui complètent la transformation du fil en lui donnant sa résistance, opèrent 2 800 tours à la minute et la bobine y est disposée de façon à régulariser l'enroulement du fil par un mouvement alternatif d'élévation et d'abaissement.
Décrire par le menu tout le travail serait trop long et nous amènerait à nous répéter, certaines fabrications étant communes à diverses usines de MM. Saint frères et l'établissement des Moulins-Bleus étant une copie perfectionnée, en quelque sorte, de celui d'Harondel. Ainsi, voici, par exemple, la transformation des bobines en grosses pelotes pour être placées sur les machines à parer ; puis la machine à bobiner spéciale pour les tisseurs de jute, et enfin des métiers à filer de quatre types différents, selon les besoins. Partout le travail est disposé à hauteur d'homme.
La filature emploie des femmes, tandis que le tissage est exclusivement réservé aux hommes, qui travaillent d'après un tarif de façon, tenu à leur disposition.
De nombreux métiers à tisser la toile de jute, depuis la largeur de 0m50 jusqu'à celle de 2 mètres, fonctionnent ici dans ces ateliers, qui ont 4m50 de hauteur intérieure, plus un toit avec ventilateur.
Les ateliers et les magasins sont couverts en tuiles recevant un revêtement intérieur de 0m05 de mortier argileux pour maintenir la température régulièrement à un certain degré.
Le balayage des ateliers s'effectue trois fois par jour. Le gain de l'ouvrier tisseur est, en moyenne, de 2 fr. 50 ; les femmes et enfants gagnent, de même, un salaire de : 1 fr. 60.
N'omettons pas de parler des pareuses, c'est-à-dire des nombreuses machines de construction variée, dont plusieurs fabriquées à l'usine même, qui donnent aux chaînes l'apprêt nécessaire. Cet apprêt consiste en une colle de fécule, additionnée d'une petite quantité d'autres substances. Les lisières qui doivent former la bordure des toiles de jute sont établies, selon le cas, soit avec des fils de coton, soit avec des fils de lin retors.
Quand une pièce sort du tissage, elle passe au cylindre, pour être métrée et pliée. C'est alors que le tissu reçoit une étiquette portant, avec les numéros d'ordre et de référence de qualité ou de genre, le métrage et le poids. Les toiles sont ensuite conduites au quai de chargement sur des wagons qui les transportent à Flixecourt pour être apprêtées ou non, suivant les cas et ensuite expédiées à leur destination.
Il n'est pas jusqu'à la cheminée de l'usine qui ne retienne nos regards, non seulement par sa hauteur de 50 mètres, mais bien plus par la perfection de sa construction.
Du reste, on observe que la maison Saint frères installe toujours avec un véritable luxe ses machines à vapeur dans tous les établissements ; ici, l'on peut dire que c'est dans un palais de marbre que fonctionne, imposante et merveilleusement entretenue dans toutes ses parties, la machine Compound de Boyer, de Lille, qui commande la filature. A côté de celle-ci, nous admirons aussi la machine il vapeur construite par Dujardin et Cie, qui commande le tissage.
Seize câbles en chanvre manille établissent les transmissions et actionnent les dynamos pour la lumière électrique. Ces câbles, fabriqués à l'usine, avec la dernière perfection, durent plusieurs années.
Une machine à vapeur de secours de 50 chevaux, de Lecouteux et Garnier, de Paris, sert habituellement à assurer l'éclairage électrique au moyen des trois dynamos qu'elle actionne, d'une puissance de 1 500 ampères.
On le voit, rien n'a été négligé pour constituer aux Moulins-Bleus des établissements modèles ; les chiffres suivants en feront, au surplus, apprécier l'importance :
Bancs à broches : 20
Machines pareuses : 18
Machines à étirage : 35
Métiers à tisser : 494
Nombre de broches (du n° 1 1/2 au n° 8) : 6120.
Ainsi que nous l'avons dit, le centre horaire de Flixecourt donne l'heure télégraphiquement à Moulins-Bleus, de même qu'aux autres usines qui, toutes ont le téléphone qui les relie, de façon permanente, pour l'exécution des ordres.
Cent cinquante maisons ouvrières, fort bien disposées et établies avec un confort d'hygiène absolu, sont réservées aux travailleurs de l'usine, à des conditions des plus favorables. Aussi, la physionomie de leurs habitants reflète-t-elle le contentement et la santé.
Les enfants de cette intéressante population ouvrière reçoivent l’instruction dans deux écoles distinctes, qui comptent présentement l'une 56 garçons et l'autre 47 filles.
Une cantine bien approvisionnée fournit aux ouvriers des aliments el des boissons, dont la qualité est soigneusement contrôlée par la direction.
Bientôt une société coopérative va fonctionner dans un bâtiment que MM. Saint frères lui érigent près de celui affecté aux écoles ; les fonds ont été réunis et le conseil nommé. En un mot, rien n'a été négligé pour rendre ici la vie facile à la classe laborieuse et la maintenir en parfait état de santé. »
| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |